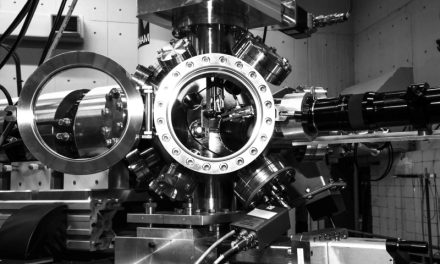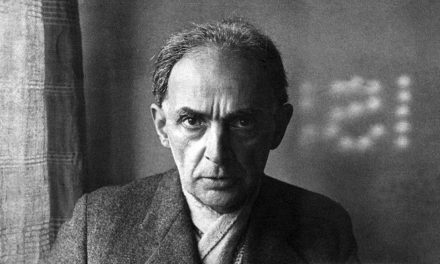L’île de Tinos, située dans les Cyclades, à proximité de Mykonos, est surtout connue pour l’église Panagia Evangelistria et l’icône réputée miraculeuse de la Vierge Marie qu’elle abrite. Ce n’est cependant pas le seul monument étroitement lié au patrimoine culturel de l’île. Les pigeonniers que l’on trouve exclusivement dans les îles des Cyclades, et en particulier à Tinos, attirent l’attention par leur structure caractéristique.

Ces petits bâtiments blanchis à la chaux et décorés avec soin, appelés peristeriones ou columbaria (de peristeri et columba, respectivement les mots grec et latin pour colombe), sont construits sur des pentes à l’abri des vents forts des Cyclades et à proximité de sources d’eau, telles que des sources d’eau, et leurs façades sont orientées vers l’espace ouvert. Beaucoup ont deux ou même trois étages, le rez-de-chaussée étant généralement plus grand. Si le site n’est pas suffisamment protégé du vent, il y a un ou deux murs latéraux pour créer un brise-vent.

La porte d’entrée est en bois, sans fissure, afin d’éviter que les prédateurs des colombes et des pigeons, tels que les serpents ou les rats, ne pénètrent dans le bâtiment. La partie supérieure du pigeonnier comporte de nombreuses ouvertures, suffisamment petites pour que seules les colombes puissent y entrer et en sortir, et non des oiseaux plus gros comme les corbeaux ou autres. Ces trous de pigeons sont créés à l’aide de plaques de schiste, une roche fissile locale, formant souvent des formes ornementales variées. Le toit est plat, en argile, et ses quatre coins sont toujours ornés de petits piliers.

L’histoire de la ville
En 1207, à la suite de la quatrième croisade, l’île de Tinos a été occupée par les Vénitiens ; elle a d’abord été saisie par la puissante famille Ghisi et, en 1390, elle a été léguée à la République de Venise, qui l’a conservée jusqu’à sa capture par les Ottomans en 1715. On pense que l’élevage de pigeons a été introduit sur l’île par les Vénitiens, qui gardaient les oiseaux principalement pour leurs fientes, le guano étant un fertilisant très efficace, largement utilisé dans l’agriculture jusqu’au début du XXe siècle.

Dans l’Europe médiévale, la possession d’un colombier était un symbole de statut et était en fait réglementée par la loi. Seuls les nobles bénéficiaient de ce privilège spécial, connu sous le terme de « droit de colombier ». Après le passage de l’île sous la domination ottomane, les habitants ont également eu le droit d’élever des pigeons, à condition de posséder des terres. De nombreux pigeonniers ont été construits à Tinos aux XVIIIe et XIXe siècles, et les habitants ont élevé des pigeons non seulement pour le guano, mais aussi pour leur viande. Aujourd’hui, l’île compte plus de 1 000 pigeonniers.

En 2021, un livre a été publié sous le titre The Dovecotes of Tinos. Strolling Through the Craft of Stonemasonry in 1955. Il contient une sélection de notes de Manuel Baud-Bovy, un étudiant de l’école d’architecture de Genève qui a visité Tinos pour la première fois en 1955 et a été impressionné par ces structures particulières. Il a exploré l’île et recensé des centaines de pigeonniers. Un autre livre sur le sujet a été publié en 2020 : The complete listing of the dovecotes of Tinos (La liste complète des pigeonniers de Tinos) de Manthos Prelorentzos.
Texte original : GreekNewsAgenda
Lire aussi sur Grèce Hebdo
Volàx deTinos | Le village avec un paysage lunaire unique, un phénomène mondial
IE
TAGS: architecture | Grèce | patrimoine